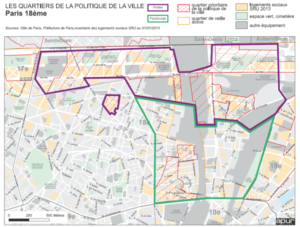Les quartiers populaires entament leur deuxième mois de confinement à
bout de souffle, mais encore soutenus par un faisceau de solidarités
inédites, réinventées dans l’urgence.
Il y a ceux qui ont encore un travail et prennent tous les risques
pour le garder. Ceux qui craignent pour l’avenir de leurs enfants. Et
il y a ceux qui ont faim. Ce sont souvent les mêmes. Les quartiers
populaires entament leur deuxième mois de confinement à bout de
souffle, mais encore soutenus par un faisceau de solidarités inédites,
réinventées dans l’urgence.
Ce matin-là, à Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), les premiers sont
arrivés à 8 heures, soit trois heures avant l’ouverture des portes de
la maison de la jeunesse de la ville. A 11 heures, la file d’attente
s’étirait sur 300 mètres. Mercredi 15 avril, ils étaient des centaines
à patienter pour remplir leurs caddies de salades, courgettes, pommes, yaourts et crème fraîche. Sans débourser un centime. Organisée par le collectif AC Le Feu et le centre social Toucouleurs, avec le soutien
de la Fondation Abbé-Pierre, cette distribution alimentaire était la
troisième en huit jours. 190 personnes se sont présentées la première
fois, 490 la seconde, puis 750.
Les 50 palettes de nourriture données par des anciens des quartiers,
grossistes, semi-grossistes et vendeurs – « qui n’ont pas oublié d’où
ils venaient », se félicite le cofondateur de l’association, Mohamed
Mechmache –, n’ont pas suffi à répondre à la demande. Du jamais vu. «
Il y a urgence dans ces territoires, tout va se casser la gueule,
alerte le cofondateur d’AC Le Feu. Des centaines de personnes que nous
ne connaissions pas sont en train d’apparaître sur nos radars. On ne
sait pas comment ils vont trouver les ressources un mois de plus pour
se nourrir. »
Dans la queue, il y avait Samia*, une aide-soignante de 42 ans, mère
de quatre enfants, dont le salaire ne suffit plus à financer le budget
nourriture du foyer, qui a été multiplié par trois depuis le début du
confinement. Il y avait Evana* aussi, la mine lasse, assise sur son
déambulateur, le visage recouvert d’une épaisse couche de fond de
teint trop clair. Evana a 48 ans mais elle en fait vingt de plus. Elle
ne s’est jamais remise d’un accident de voiture qui l’a laissée avec
un bassin cassé. C’était en 2014. Depuis, elle n’arrive pas à rester
debout plus de quelques minutes et vit d’une petite pension
d’invalidité qui ne suffit pas à payer son loyer. Le confinement est
en train de la clouer sur place. Jusqu’à présent, ses amis et sa
famille l’aidaient à boucler ses fins de mois en lui donnant des «
petits billets de 10 euros ou 20 euros par-ci par-là, mais ils ne
peuvent plus venir me voir, alors j’accumule les dettes et je n’ai
plus rien pour nous nourrir, moi et ma fille ».
Pour des familles, la cantine est le seul repas de l’enfant
Lors de son allocution du 13 avril, Emmanuel Macron a annoncé le
versement d’une aide financière exceptionnelle pour « les familles
modestes avec des enfants afin de leur permettre de faire face à leurs
besoins essentiels ». Chaque famille bénéficiaire du RSA ou de
l’Allocation de solidarité spécifique (ASS) recevra 150 euros, plus
100 euros par enfant, et les familles touchant des aides au logement
percevront 100 euros par enfant. « Pffff…, souffle Ahmed*, ça ne va
pas suffire. » Ahmed n’est pas du genre commode. Père autoritaire de
sept enfants, il est au chômage partiel depuis que le restaurant dans
lequel il fait la plonge a fermé ses portes. « A force de rester là
sans rien faire, mes enfants ont faim toute la journée et ce que je
touche ne suffit pas ! », lance-t-il, sur les nerfs. Avec l’arrêt de
la cantine à 1 euro le déjeuner, il n’a plus les moyens de subvenir
aux besoins de sa famille. Une situation qu’il vit comme une
humiliation. A peine évoqué les paniers repas qui lui sont offerts par
une association et il raccroche sans préavis.
« Dans certaines familles très modestes, le repas de la cantine est le
seul repas de la journée de l’enfant, témoigne Eddy*, 42 ans,
éducateur de vie scolaire dans un lycée du département, qui, « en
temps normal », distribue des barquettes à emporter composées des
restes du jour aux élèves les plus démunis. « Avec le confinement,
nous avons créé un groupe WhatsApp pour tenter d’identifier les plus
en difficultés et chacun de nous achète ce qu’il peut pour eux. Le
Coronavirus a un effet loupe sur tous les dysfonctionnements et toutes
les inégalités. »
Ahmed reçoit ses paniers de l’association Têtes grêlées, lancée par
Sylla Wodiouma, surnommé « Djoums » dans le quartier des
Quatre-Chemins, à Pantin. Le jeune homme de 34 ans distribue chaque
semaine quelques dizaines de « kits » composés de nourriture et de
produits d’hygiène qu’il a pu financer grâce à l’appel aux dons lancé
sur la plate-forme Leetchi. Il a récolté un peu plus de 6 000 euros en
trois semaines. « Beaucoup de familles qui travaillaient en tant
qu’intérimaires ou non déclarées n’ont plus rien, elles ont tenu deux
semaines et puis tout s’est effondré », raconte Djoums. Les listes de
personnes à soutenir, dont les noms lui sont signalés par des voisins,
des travailleurs sociaux et des amis, « explosent », témoigne-t-il.
Tenaillée par la « honte »
Sur ces listes, figure désormais Nassira*. La jeune femme de 29 ans
parle à voix basse pour ne pas réveiller ses quatre filles âgées de 13
ans à cinq mois. Il est pourtant midi. « Les aînées se couchent vers 2
heures du matin et je les laisse dormir le matin, je les réveille à
l’heure du déjeuner, peu avant de mettre les petites à la sieste,
comme ça, elles peuvent être un peu tranquilles pour faire leurs
devoirs. » Sans travail ni mari, elle vit des allocations familiales
et accueille dans son petit deux pièces de 41 mètres carrés du
quartier des Courtillières son père de 65 ans atteint d’un cancer du
foie. Elle dort avec ses quatre filles dans une chambre minuscule et
ne veut surtout pas qu’elles sachent qu’elle n’a plus les moyens de
les nourrir. « Qu’est-ce que mes enfants vont penser de moi, que je ne
suis pas capable de prendre soin d’elles ? » confie-t-elle, tenaillée
par la « honte ».
Fatoumata* elle aussi a honte. Et peur. Sans-papiers ivoirienne, elle
se terre avec ses trois enfants dans une modeste HLM d’une cité de
l’Essonne qu’elle sous-loue pour 300 euros par mois. Elle n’est pas
sortie de chez elle depuis le début du confinement, pas même pour
faire des courses, terrorisée à l’idée d’être contrôlée par la police
omniprésente et susceptible de lui demander attestation et pièce
d’identité à tout instant. Impossible de se faire livrer, elle n’a
plus un sou. La nourriture commence à manquer. Fatoumata travaillait
jusqu’au début du mois de mars : elle faisait des ménages dans des
hôtels en « empruntant » les papiers d’une autre moyennant 20 % sur
les sommes qu’elle rapporte. Mais il ne reste rien des 800 euros
gagnés entre le mois de février et le début du mois de mars. C’est sa
fille aînée de 16 ans qui a fini par lancer un SOS à la responsable
d’une association de quartier qu’elle a l’habitude de fréquenter. La
directrice a mis 80 euros de sa poche pour lui faire un premier marché
et le déposer devant sa porte. « Toutes les associations et les
centres sociaux sont fermés, les gens ne savent pas vers qui se
tourner », dit-elle. L’une de ses collègues a pris la suite la semaine
suivante.
Au moment où certaines familles apparaissent pour la première fois sur
les radars des associations, d’autres, au contraire, ne répondent plus
à l’appel. Comme en témoigne une professeure de français dans un
collège de Seine-Saint-Denis qui dit avoir perdu le contact avec 40 %
de ses élèves. Dans les quartiers Nord de Marseille, Fatima Mostefaoui
tire la sonnette d’alarme. Dans un texte rédigé au nom du collectif
des femmes des quartiers populaires, elle écrit : « Je suis pauvre,
triste, un peu en colère ; non, beaucoup en colère (…). Hier déjà dans
ma cité, la réussite scolaire était un rêve inaccessible. Alors là,
pour moi, l’école à la maison, c’est un tsunami qui va me noyer et
emporter mes enfants ». Fondatrice de l’association Avec Nous, la
militante a lancé l’opération « Partage ton Wi-Fi » pour inciter les
résidents qui disposent d’un réseau Internet à en faire bénéficier
leurs voisins en dévoilant leurs codes d’accès.
A deux doigts de « tout lâcher »
Nadia*, elle, est à deux doigts de « tout lâcher », le suivi des
devoirs à la maison auxquels elle « ne comprend rien », les courses au
rabais qui l’obligent à nourrir ses deux enfants de pain fait maison
et de pâtes, les négociations « qui n’aboutissent à rien » avec son
bailleur social pour lui permettre d’échelonner le paiement de son
loyer. A 45 ans, elle vit dans le 3e arrondissement de Marseille, l’un
des plus pauvres de la cité phocéenne. Le 17 mars, premier jour du
confinement, elle a perdu son travail − au noir, en tant que femme de
ménage pour des particuliers − et la rémunération qui allait avec − un
peu moins de 500 euros par mois. « Ma voisine est en dépression, je ne
vais pas tarder à la suivre », annonce-t-elle en aspirant sur sa
cigarette. Elle n’a qu’une crainte : que cette épidémie de Covid-19 «
détruise l’avenir de [ses] enfants ». Son fils, lycéen, et sa fille,
collégienne, sont en train de « perdre le fil », dit-elle, et
d’accumuler un retard qu’ils ne sont pas sûrs de pouvoir rattraper
malgré le prêt d’un ordinateur via l’association Avec Nous.
A 800 kilomètres de là, on a croisé Sofia* sur un bout de trottoir de
Clichy-sous-Bois, un cabas dans chaque main remplis de denrées
gracieusement distribuées par AC Le Feu. 16 ans à peine, silhouette
fluette, mots écorchés, cette « fervente lectrice » d’Emile Zola
évoque sa mère, femme au foyer, son père, qui a pris la poudre
d’escampette, elle raconte les efforts « immenses » qu’elle fournit
pour figurer parmi les premières de sa classe de 2nde, parle de «
l’influence de son milieu » qui la condamne « à la misère » pour
résumer l’angoisse de ce confinement et des conséquences « tragiques »
sur sa vie, elle raconte les « droits qu’elle n’a jamais eus » et les
« chances qu’elle n’aura jamais plus ». Elle en est convaincue. Sofia
est en colère, elle est en train de décrocher, et elle le sait.
Impossible de suivre le rythme de l’école à la maison. Chez elle, «
pas d’ordinateur, pas d’imprimante, un seul téléphone pour quatre
enfants ». Tout est dit. Elle tourne les talons. « Si ceux qui ont de
la chance dans la vie s’inquiètent de l’après, interroge Mohamed
Mechmache, imaginez ce que ressentent ceux qui n’ont rien. » Ou si
peu.
Le père Patrice Gaudin les voit chaque matin aux arrêts de bus, les
aides-soignantes, les caissières, les livreurs, les travailleurs du
BTP, les éboueurs. Chaque matin, il voit ces « colonnes de
travailleurs de l’ombre » passer devant son église du christ
Ressuscité plantée au cœur de Bondy Nord, en Seine-Saint-Denis, tous
ces « héros silencieux de nos cités » dont il admire le « sens du
devoir ». Le « père Patrice », comme l’appellent les résidents du
quartier, se dit « horrifié » par les inégalités que génère ce
confinement. Avec sa carrure de rugbyman et son franc-parler − « avant
d’arriver ici il y a cinq ans, j’y connaissais que dalle aux cités »
−, il veut défendre l’honneur de ceux dont « on dit trop souvent
depuis quelques semaines qu’ils ne respectent pas les règles du
confinement » et à qui « on ne rend pas assez justice » malgré les
risques auxquels ils sont exposés au quotidien.
La conviction d’avoir « un rôle important »
Keltoum* a subi les foudres de son mari, furieux qu’elle se mette en
danger. « Il aurait préféré que je m’arrête, mais finalement il a
compris. » La jeune femme de 36 ans a dix ans de labeur dans la grande
distribution derrière elle et la conviction d’avoir « un rôle
important ». Elle occupe le poste de manager dans les rayons d’un
petit supermarché du 93. Six de ses collègues ont fait valoir leur
droit de retrait. Ils ont été remplacés par des étudiants de
l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis. « Il faut faire tourner le
magasin, dit-elle. Si je m’absente, il n’y aura plus rien dans les
rayons. »
Keltoum est responsable des commandes et du réapprovisionnement. A
l’occasion, elle fait aussi des remplacements en caisse. Depuis le 17
mars, le panier moyen du consommateur a presque doublé, passant de 12
euros à 22 euros. « Les gens achètent plus, du coup, j’ai une charge
de travail deux à trois fois supérieure à la normale, le tout dans une
atmosphère très pesante », confie-t-elle. Tous les jours depuis un
mois, la jeune femme adopte le même rituel en rentrant chez elle :
elle ouvre la porte, pose son sac à terre, retire ses chaussures, se
déshabille dans l’entrée, met le tout à laver et fonce sous la douche.
« J’essaie de pas être parano mais il y a de l’angoisse, et encore,
heureusement qu’on a des visières maintenant pour nous protéger des
clients. »
Depuis trois semaines, Phaudel Khebchi passe ses journées à imprimer
des visières en 3D qu’il distribue ensuite aux caissières et aux
personnels soignants des commerces et hôpitaux voisins. Directeur du
musée numérique la Micro-Folie, à Sevran (93), il a déjà fabriqué plus
de 200 visières qu’il a appris à confectionner grâce aux fiches
techniques partagées sur Internet par les « makers » des visières
solidaires. « Le plus pénible, se désole Keltoum, c’est de voir que
beaucoup de gens n’ont rien changé à leurs habitudes, ne serait-ce que
par respect pour nous. Ils viennent faire leurs courses tous les
jours, parfois plusieurs fois par jour, et parfois, seulement pour
s’acheter une barquette de fraises. »
« Si on se retire, qu’est-ce que les gens vont devenir ?, lance
Sosthène*, le directeur du supermarché, tout aussi habité par sa
mission que sa manager des rayons. On est un peu comme le personnel de
santé, on a besoin de nous. » Lorsqu’il a entendu la ministre du
travail, Muriel Pénicaud, le 1er avril, inviter les entreprises
privées à verser une « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat »
(défiscalisée et exonérée de charges salariales et patronales) de 1
000 euros destinée à « soutenir ceux qui sont au front », il a cru
pouvoir annoncer une bonne nouvelle à ses 25 salariés. « Sauf que pour
l’instant, personne ne nous en a parlé, s’inquiète le directeur. Cette
prime, c’est une aide financière, oui, mais pas seulement, c’est aussi
une forme de reconnaissance dont nous avons tous besoin pour tenir le
coup psychologiquement. »
« Moi, la prime de 1 000 euros, je n’y ai pas droit ! », affirme
Stéphane Lafeuille. Depuis trois ans, le quadragénaire est éboueur
intérimaire à Champigny-sur-Marne (Seine-et-Marne). Il n’a jamais
décroché de CDI, il enchaîne les contrats journaliers payés au smic. «
Avec mes collègues intérimaires, on vit dans la grande précarité. Si
on remplit le frigo, on chope le corona. » Avant l’intervention de
Mamadou Sy, commercial et conseiller municipal, qui a dégoté un lot de
100 masques qu’il a distribué aux éboueurs de la ville, il travaillait
sans aucune protection. « Aujourd’hui encore, on fait nos tournées
avec des petits gants en plastique alors que les poubelles des
particuliers débordent et que les gens jettent leurs déchets médicaux,
leurs mouchoirs, leurs masques et leurs gants en vrac dans les
poubelles aux couvercles jaunes normalement exclusivement dédiées au
tri sélectif, dénonce-t-il. L’angoisse est permanente, si j’attrape le
virus, je n’ai rien, aucun filet de sécurité. » Impossible d’exercer
un quelconque droit de retrait, il n’est pas salarié.
« A ce rythme, dans un mois, nous, travailleurs au noir, travailleurs
précaires, habitants des quartiers, enfants des quartiers, on va se
retrouver définitivement hors-jeu, redoute Nadia, de Marseille. Pour
l’instant, on tient grâce aux solidarités locales et parce qu’on ne
veut pas se laisser faire. Mais pour combien de temps encore ? »