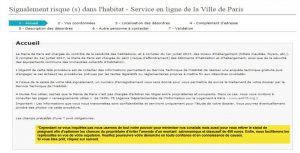Source: https://www.juripole.fr/gip_droit_justice/SONDAGE/sondage.html
Le Groupement d’Intérêt Public « Mission de Recherche Droit et Justice » a été créé en 1994 à l’initiative conjointe du ministère de la Justice et du Centre National de la Recherche Scientifique.
Il a pour objectifs
– de définir une politique scientifique de recherche pluriannuelle sur les questions intéressant le Droit et la Justice.
– de mettre en oeuvre une programmation cohérente faisant appel à toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
– de diffuser et de valoriser auprès des divers publics concernés les résultats des travaux qu’il a financés.
![]() I. L’enquête quantitative
I. L’enquête quantitative
![]() Une institution qui souffre d’un déficit de confiance
Une institution qui souffre d’un déficit de confiance
![]() Le discours de l’expérience
Le discours de l’expérience
![]() Des acteurs compétents
Des acteurs compétents
![]() La réforme des moyens
La réforme des moyens
![]() La réforme des principes
La réforme des principes
![]() II. L’enquête qualitative : bilan de l’existant et perpectives pour une réforme de la justice
II. L’enquête qualitative : bilan de l’existant et perpectives pour une réforme de la justice
![]() Pour un accès plus facile à l’information judiciaire
Pour un accès plus facile à l’information judiciaire
![]() La permanence de problème anciens
La permanence de problème anciens
![]() De nouvelles institutions judiciaires
De nouvelles institutions judiciaires
![]() La justice face à la police, aux médias et au monde politique
La justice face à la police, aux médias et au monde politique
![]() La formation
La formation
![]() L’espace judiciaire européen
L’espace judiciaire européen
Dans le cadre de son programme scientifique pour 1997, le G.I.P. Mission de Recherche Droit et Justice a entrepris de consulter les Français sur l’image qu’ils se font de la Justice ainsi que sur leurs attentes à son égard.
Une enquête par sondage auprès d’un échantillon représentatif de plus de 1000 personnes et par entretien avec 21 professionnels du Droit et de la Justice a été réalisé en juin dernier.
Ce numéro spécial du bulletin d’information du G.I.P. en présente les principaux résultats. Les données recueillies ont été mises en perspective avec les enseignements d’un sondage comparable réalisé en 1991.
| Fiche techniqueLa conception du sondage a été confiée à l’institut CSA auquel le GIP a apporté son concours. Le questionnaire a été administré entre le 12 et le 24 juin 1997 à un échantillon national représentatif de 1042 personnes âgées de 18 ans et plus. Les réponses apportées à chaque question ont été mises en perspective avec divers renseignements concernant l’interviewé : pratique religieuse, proximité partisane, vote lors des deux tours de la dernière élection présidentielle, attitude générale face à la réforme de la Société, jugement global relatif au fonctionnement de la Justice et expérience (ou non-expérience) judiciaire préalable. Les entretiens approfondis qui constituent la matière de la seconde partie de l’enquête ont été menés à la même époque en situation de « face à face » à partir d’un canevas élaboré conjointement par l’institut CSA et le GIP. Ils ont été effectués auprès de 21 personnes, représentatives majoritairement du monde des professionnels de la Justice (magistrats, avocats, greffiers, avoué, experts, huissier et notaires). Cinq personnes extérieures à ce milieu ont également été entendues : deux élus, un journaliste, un syndicaliste et un religieux. |
Oui Non N.s.p.p.

L’analyse détaillée des réponses apportées à cette question révèle que la défiance envers la Justice ne présente pas de différences majeures selon les différentes catégories de la population, à l’exception cependant des 35-49 ans (66% contre 55% en moyenne), des patrons de l’Industrie et du Commerce (70% ) et des électeurs d’extrême-Droite (70%). La désapprobation globale à l’égard de la Justice est également plus forte de la part des personnes qui ont eu affaire à elle (65% de défiance contre 55% en moyenne). Un « pic » dans l’expression de ces avis critiques (79%) est enregistré chez les personnes qui déclarent être favorables à la transformation de la société, traduction probable d’un souci plus grand de justice sociale.
Même si leur jugement global est en évolution légèrement positive depuis le début de la décennie une forte majorité des répondants (66% contre 71% en 1991) disent encore que la Justice fonctionne « assez mal » (42%) ou « très mal » (22%). Un tiers de l’échantillon estime qu’elle fonctionne « bien » (ils n’étaient qu’un sur quatre en 1991), 1% seulement déclarant qu’elle fonctionne « très bien ». En contrepoint de cette timide amélioration du jugement global, les opinions relatives à l’indépendance de la Justice se sont dégradées : 79% des Français (toutes préférences politiques confondues) pensent en effet en 1997 qu’elle est « plutôt dépendante » du pouvoir politique (ils n’étaient « que » 60% en 1991), 15% (contre 26% en 1991) exprimant un avis contraire. Il est à noter que les cadres supérieurs, modérés dans leur appréciation antérieure, se montrent plus sévères en 1997.

Symbole républicain par excellence, la Justice est aussi perçue comme impuissante à assurer un traitement égalitaire à l’ensemble des Français, qui la jugent inégalitaire à la fois dans son accès (selon 79%, l’accès n’est pas égal pour tous ») et dans ses décisions (seuls 27% des Français pensent que « les justiciables sont égaux devant les tribunaux). En outre, si l’action quotidienne de la Justice fait l’objet d’appréciations plutôt positives quand il s’agit d’affaires civiles (pour 60% des répondants) ou de conflits du travail (47%), l’institution judiciaire est considérée comme désarmée lorsqu’elle s’affronte aux problèmes sociaux actuels. Ainsi, en matière de défense des libertés et des droits fondamentaux, de traitement des affaires pénales, de lutte contre la drogue, contre la délinquance financière ou la corruption, la balance des opinions devient nettement négative, à des degrés plus ou moins prononcés (de -10 à -56 points) selon les domaines envisagés.
Dans une société où les régulations traditionnelles sont de moins en moins efficientes et où les rapports sociaux se complexifient, la demande d’arbitrage explose, exposant la Justice à des attentes de plus en plus pressantes qui dépassent souvent ses compé -tences et ses moyens.

Les reproches qui sont adressés par les justiciables à l’institution judiciaire se répartissent sur de nombreux motifs d’insatisfaction. Qu’ils aient eu ou non recours à la Justice, les Français sont critiques quant à la complexité du langage judiciaire, la durée des procédures, le coût des actions et l’accès à l’information. Pour chacun de ces item, les opinions critiques sont très élevées (de 58% pour l’accès à l’information à 96% pour la durée des procédures), comparables quantitativement d’une enquête à l’autre.
Chez les personnes ayant eu recours à la Justice seul l’accueil reçoit l’approbation : 57% d’entre elles (mais elles étaient 60% en 1991) estiment avoir été bien accueillies. En revanche elle déplorent majoritairement le déficit d’information : 57% (contre 55% en 1991) disent avoir été « mal renseignées », point de vue partagé par 42% des non-usagers qui déclarent qu’il n’est pas facile d’obtenir des renseignements.
Jugée lente, onéreuse, complexe et peu accessible, la Justice est considérée en outre comme médiocrement efficace dans son rôle de protection des victimes. Si les réponses aux questions d’opinion portant sur sa capacité à assurer leur protection (55% d’avis positifs), à les accueillir ou à leur permettre d’obtenir réparation (46% d’avis positifs sur ces deux points) sont proches de la moyenne, ces scores se dégradent (entre 30 et 40% d’approbation) lorsqu’il s’agit de jugements sur le traitement réel des victimes au terme des procédures. L’analyse montre également que ces opinions sont encore plus accusées de la part de ceux des répondants qui ont eu une expérience judiciaire. Au final une conclusion massive s’impose : « il vaut mieux s’arranger à l’amiable ». Mais une différence sensible sépare toutefois quant à cette proposition ceux qui ont eu recours à la justice (d’accord à 80% avec cette assertion) et ceux qui n’y ont pas eu recours (69%).
C’est de la part des professionnels de la Justice, magistrats et avocats principalement, que les Français attendent les impulsions qui permettront à l’institution judiciaire de se réformer. La compétence et la qualité du travail de ces professionnels paraissent constituer des atouts essentiels dans la perspective espérée d’une réforme fondée sur un retour aux principes et une amélioration des moyens.
Les avocats bénéficient dans l’opinion d’une image plutôt favorable. Quatre caractéristiques sur les six à propos desquelles un avis était sollicité recueillent des réponses positives, voire très positives de la part des répondants. C’est ainsi que les avocats sont considérés comme compétents (78% d’avis favorables), accueillants (76%), facilement accessibles (57%) et s’occupant bien des affaires qui leur sont confiées (54%). En revanche le coût de leur intervention est considéré comme trop élevé (93%) et leur honnêteté n’est reconnue que par 39% des personnes sondées.

La ventilation des réponses à ces questions entre les personnes ayant eu affaire à la Justice et les autres montre qu’il existe chez les premières une plus grande réserve envers les avocats..
Ces données qui restent assez sommaires incitent à penser qu’en tant que relais quasi quotidiens de l’institution judiciaire, les avocats contribuent à rendre celle-ci moins lointaine des justiciables.
L’analyse de l’image des magistrats fait ressortir plus clairement la fragilité de la confiance que les Français accordent aux professionnels de la Justice. On s’accorde largement à les décrire comme « débordés de travail » (77%), compétents (71%) et correctement rémunérés (63%). Les avis sont plus partagés mais encore positifs quand il est question de leur courage (57%) de leur honnêteté (47%) ou de leur capacité à comprendre la société (44%).
Mais le jugement vire au négatif quand on évoque leur impartialité (39%) leur indépendance vis-à-vis des milieux économiques et financiers (21%) et, surtout, du pouvoir politique (17%).
L’examen des réponses des personnes ayant eu recours à la Justice traduit une attitude plus critique de leur part à l’égard des magistrats, cette réserve ne s’appliquant pas aux appréciations concernant la compétence.
Les diplômes et la sympathie politique nuancent également les opinions. Les diplômés de l’Enseignement supérieur sont plus nombreux à reconnaître la compétence (80%) et l’honnêteté (54%) des juges que les non-diplômés (61% et 44%). Des écarts se manifestent également entre sympathisants de Gauche et de Droite, les premiers étant moins indulgents dans leur estimation de la compétence (71%), de l’honnêteté (48%), de la compréhension (44%) et de l’équité (38%) des magistrats que les électeurs de Droite qui les créditent respectivement de 82%, 57%, 56% et 50% d’avis positifs sur ces items. En revanche la proximité partisane joue peu sur le sentiment de dépendance vis-à-vis du pouvoir politique qui est très largement partagé par les deux groupes.

Ces données conduisent au constat qu’à la fois l’institution et, dans une moindre mesure, ses acteurs, manquent de crédibilité. Mais la question reste entière de savoir quel prix les Français sont prêts à payer pour une réforme en profondeur de la
Justice qui donnerait à celle-ci plus d’efficacité et d’équité, tout en lui conservant son statut de gardienne des grands principes.
Pour 56% des répondants, il ne doit pas être dérogé au principe du secret de l’instruction, droit fondamental des citoyens. Le souci de protection de l’individu mis en examen l’emporte donc sur l’information du citoyen qui n’est que pour 37% des répondants, un argument de nature à entraîner l’aménagement, voire la disparition du secret.
L’attachement à ce principe du secret de l’instruction est d’autant plus grand que les Français ont le sentiment croissant qu’il est en danger. La menace la plus forte ne vient pas, selon eux, des milieux judiciaires puisqu’une majorité des répondants estime que les avocats (62%) et les magistrats (51%) le respectent bien. Ce sont les policiers (68%) et, surtout, la presse (86%) qui sont considérés comme peu respectueux de ce principe, révélant la perception d’un véritable antagonisme entre des univers (l’Information et la Justice) qui participent pourtant l’un comme l’autre à la défense des libertés individuelles.

Si la liberté de l’information n’est donc pas une priorité, la volonté de réforme exprimée par le politique et l’opinion publique se rencontre en revanche sur deux axes majeurs : la réforme des moyens attribués au ministère de la Justice et la volonté d’aménager, sinon de briser, le lien entre pouvoir politique et magistrature.
Parmi les propositions visant à une plus grande efficacité de la Justice au quotidien, 58% des questionnés souhaitent que « les affaires soient jugées plus rapidement », 44% qu’on améliore l’indemnisation accordée aux victimes et 38% que soit « mise en place une justice de proximité pour régler les petites affaires au niveau local ». L’analyse détaillée des réponses à ces propositions fait apparaître, évidemment, une adhésion encore plus large à ces objectifs de la part de ceux qui ont eu affaire à la Justice.
Le principe de l’échevinage, c’est à dire du recours à des juges non-professionnels, est approuvé largement quand il est question de l’appliquer au traitement des petits délits (76% d’opinions favorables) ou aux affaires concernant la famille (67%). Sans perdre sa spécificité, l’institution judiciaire, en s’ouvrant à des profanes », se trouverait certes désacralisée mais gagnerait en proximité et en connaissance concrète des problèmes quotidiens des Français.

S’agissant du lien entre les Procureurs et le Ministre de la Justice une nette majorité (57% contre 31%) des personnes interrogées estime qu’il doit être aboli, même si l’homogénéité de la politique pénale devait en souffrir, ce point de vue caractérisant davantage l’opinion des personnes se situant politiquement « à Gauche ». La ventilation des réponses apportées à cette question montre que les partisans de la rupture du lien de sujétion sont plus nombreux à mesure que le degré d’instruction s’élève mais qu’en revanche les jeunes (18-24 ans) sont majoritairement favorables à son maintien (37% contre 31%). Subsidiairement la suggestion d’élire les juges – sur le modèle américain – n’entraîne guère d’enthousiasme, ne recueillant que 14% d’avis favorables, en raison sans doute de son éloignement de la tradition judiciaire française.
Enfin l’accroissement des attributions du Conseil Constitutionnel, perçu comme garant des droits et libertés et arbitre suprême, est également souhaité par une large majorité (63%), un Français sur cinq seulement estimant au contraire que cette institution dispose en l’état des moyens de défendre efficacement les droits et les libertés des citoyens. Quant aux modalités de la saisine de cette juridiction, si 85% des personnes interrogées sont favorables à son ouverture à tout citoyen, un tiers d’entre elles uniquement estime qu’il s’agit d’une question prioritaire.
A ces initiatives des milieux professionnels s’ajoute la reconnaissance du caractère positif de l’action des associations qui permet de dédramatiser le recours au judiciaire et d’agir efficacement en matière de conseil et d’aide aux victimes. Cette opinion très favorable est à peine nuancée par des réserves liées à la propension procédurière des groupements d’intérêts et à l’accroissement du nombre des petits contentieux que leur intervention suscite.
Deux grandes pistes sont privilégiées pour améliorer l’accessibilité à la Justice : le développement des structures d’orientation, d’assistance et de conseil aux justiciables (maisons de Justice, services de conseils juridiques dans les mairies …) et la formation d’une véritable « culture juridique » des Français avec l’aide notamment de l’école et des médias, par le biais de la formation civique et d’une éducation juridique.
De telles dispositions risqueraient cependant, en cas de succès, de produire des effets non désirés, un accès à la Justice entraînerait en effet presque mécaniquement un accroissement quantitatif du recours au juge. Pour tenter de résoudre la contradiction entre ouverture et engorgement il est fréquemment suggéré de s’inspirer du pragmatisme anglo-saxon et d’imaginer de nouveaux modes de règlement pré-judiciaire des conflits afin d’éviter que les tribunaux soient massivement saisis à propos de petits contentieux.
A côté de ces questionnements sur les moyens d’un accès plus simple et plus rationnel à la Justice s’exprime une inquiétude quant à la « perte de sérénité » dont souffre l’institution à la suite des débats de société dont elle a été récemment l’objet. Cette crise s’articule autour d’un principe, la détention provisoire et de deux notions très interdépendantes, le secret de l’instruction et la présomption d’innocence.
L’utilisation de la détention provisoire à des fins d’intimidation ou de coercition est dénoncée comme une véritable « dérive » dont l’une des causes est la solitude du juge d’instruction. Pour y remédier, deux suggestions sont faites : instaurer une collégialité de la décision d’incarcération et mettre en place un « tribunal de la liberté », juridiction indépendante devant laquelle pourrait être organisé un débat contradictoire avant toute mise en détention provisoire.
Sur le secret de l’instruction et la présomption d’innocence, les professionnels expriment des avis nettement plus nuancés que le grand public. Le difficile équilibre à tenir entre ces deux principes ne conduit généralement pas à proposer des solutions radicales. La réflexion s’oriente plutôt vers une limitation de la durée du secret pour pallier les effets de la longueur excessive des procédures et, afin de préserver le droit des citoyens à être informés sur les actes des élus et des détenteurs d’une charge publique, vers la mise en place de dérogations au caractère absolu du principe. Naturellement ces propositions ne font l’objet d’aucun consensus et n’apparaissent qu’à titre d’hypothèses.
A l’inégalité des justiciables devant la Justice, les professionnels associent deux séries de facteurs. Il s’agit d’une part de la multiplicité des contentieux à enjeux modestes pour lesquels « le jeu ne vaut pas la chandelle », décourageant les citoyens les plus modestes d’engager des procédures et, d’autre part, de la complexité croissante du droit qui impose de faire appel à des spécialistes compétents et donc chers dont beaucoup de justiciables ne peuvent s’offrir les services, compte-tenu des limites très étroites des conditions d’accès à l’aide juridictionnelle. Il s’ensuit que certaines catégories sociales sont quasi exclues de fait de l’accès à la justice – les classes moyennes relativement et les plus défavorisées presque absolument – les SDF constituant « une catégorie de véritables non-justiciables ».
Afin de répondre à ces défis certains professionnels proposent la mise en place d’un dispositif de garantie de protection juridique financé par un système de cotisation, voire par l’impôt.
Le sentiment qui prévaut de la part de nombreux professionnels est celui d’une institution qui reste, malgré d’indéniables assouplissements, trop « séparée de la vie que connaissent les Français tous les jours« . L’une des causes de cette séparation tient d’abord à la solennité du rituel selon lequel la Justice est rendue. Deux attitudes contradictoires sont perceptibles parmi les professionnels de la Justice sur cette question.: la première consiste à considérer la solennité de la Justice comme une garantie de sa légitimité, la seconde à ne voir dans le cérémonial qu’un moyen destiné à éloigner les justiciables, un « abus de pouvoir symbolique ».
L’amélioration de la place faite à la victime au sein de l’institution judiciaire apparaît par ailleurs comme peu discutable. Les progrès constatés sont encore jugés très insuffisants et l’image d’une Justice davantage préoccupée par les délinquants que par leurs victimes demeure prégnante. C’est la réalité de la mise en oeuvre des réformes plus que leur intention qui soulève des réserves. Les indemnisations accordées sont considérées comme purement symboliques par rapport aux préjudices subis et les prises en charge psychologiques offertes aux victimes, comme réduites à leur plus simple expression.
La variété des solutions proposées pour résoudre ce problème témoigne d’une part de son importance et, d’autre part, de l’absence de consensus sur les moyens d’y remédier. Parmi les suggestions le plus fréquemment exprimées on peut citer la création, au sein de l’institution judiciaire, de structures d’aide et d’encadrement des victimes, le soutien au développement du réseau associatif, l’organisation de rencontres agresseur/victime, la mise en place d’un accompagnement judiciaire du « témoin-victime assisté« , la création d’un fonds de garantie d’indemnisation et la manifestation, de la part de la Justice, d’un véritable intérêt pour les victimes par le moyen, par exemple, d’une meilleure information.
Les limites du développement de la place accordée aux victimes dans le processus judiciaire sont toutefois clairement perçues et identifiées comme ne devant pas conduire à transformer la Justice – qui est rendue au nom du peuple français et non pour des particuliers – en un « service public de la vengeance privée ».
La surabondance des affaires à traiter est le reproche principal que les professionnels adressent au fonctionnement actuel de l’institution judiciaire, point sur lequel les magistrats sont naturellement le plus vivement critiques. Le manque de moyens matériels et humains est dénoncé comme la cause principale de cet engorgement dont les conséquences directes (allongement des délais générateurs de lourds préjudices pour les justiciables, pratique de classement systématique des petits contentieux) sont porteuses d’une perte de crédibilité de l’institution judiciaire. A ce problème les professionnels proposent une solution immédiate, l’augmentation significative des moyens, c’est à dire du budget de la Justice, fréquemment annoncée mais rarement concrétisée. Secondairement il est suggéré que l’introduction de nouveaux modes de traitement des affaires judiciaires serait de nature à soulager des tribunaux asphyxiés par les contentieux de masse.
De la médiation les personnes interrogées attendent davantage de rapidité (la procédure est moins formelle et plus directe), une grande efficacité (elle est réputée conduire à un résultat clair), un désengorgement de l’activité des tribunaux et la réalisation d’économies tant pour les justiciables que pour l’institution judiciaire.
Cette technique n’est cependant pas présentée comme la panacée. Elle ne pourrait évidemment concerner que les « petites affaires » (enjeux limités et faits simples). Certains redoutent aussi qu’elle entraîne un risque de banalisation de l’acte judiciaire en ôtant aux décisions qui en seraient issues la solennité induite par la procédure classique et qu’elle souffre d’un statut dégradé de sous-administration de la Justice si elle devait être privée des garanties (respect du contradictoire, voies de recours) qui accompagnent le procès judiciaire.
L’intérêt qu’inspire le recours à des juges non-professionnels dans un nombre croissant d’espèces est grand. Une telle novation entraînerait une meilleure ouverture du monde judiciaire sur le monde social, l’introduction d’un élément de « compréhension intuitive » dans la procédure de jugement et d’un facteur de pacification dans les contentieux ainsi qu’une opportunité de traiter et de régler les phases de pré-contentieux dans les délits mineurs. Mais des réserves sont cependant exprimées. Il apparaît ainsi nécessaire de donner une formation théorique aux juges non-professionnels et de cantonner leur action à des domaines qui ne touchent pas aux libertés publiques.
L’échevinage, compris dans cette étude comme l’introduction de non-professionnels aux côtés de juges professionnels, constitue également une proposition qui retient l’intérêt des personnes interrogées.
Les avantages attendus de cette formule de mixité sont liés à un enrichissement réciproque, le juge non-professionnel apportant à la décision sa connaissance du milieu, le juge professionnel sa caution juridique et judiciaire. A contrario le système est perçu comme difficile à mettre en place (question des critères en fonction desquels on déterminera les juridictions au sein desquelles se pratiquera ou non l’échevinage). Il est en outre soupçonné d’être porteur d’une logique qui irait dans le sens de la délégitimation du juge puisqu’il signifie que celui-ci avouerait implicitement son incapacité à juger par ses vertus ou son statut propres.
Le recours aux juges non-professionnels, quel que soit le cadre dans lequel il est envisagé, est donc un principe qui, sans être dépourvu d’avantages aux yeux des professionnels, n’est pas exempt de réserves. Celles-ci tiennent à la fois aux conditions pratiques de la formation et de l’intervention des intéressés et à l’effet que la généralisation d’une telle pratique pourrait avoir sur l’image et le fonctionnement de la Justice.
Le corps des fonctionnaires de Police est considéré de manière positive par les gens de Justice qui reconnaissent en outre que leurs partenaires judiciaires bénéficient d’une image sociale moins flatteuse que la leur.
Cependant de nombreux professionnels de la Justice portent une appréciation mitigée sur la manière dont sont respectés les droits des personnes interpellées pendant la phase précédant l’intervention du Juge d’Instruction, notamment la garde à vue. Pour plusieurs d’entre eux une amélioration pourrait être induite par une clarification (au bénéfice de la Justice) de la double hiérarchie qui s’impose aujourd’hui à la Police.
Les relations que les professionnels du Droit entretiennent avec la Presse sont à la fois plus passionnées et considérées comme décevantes. A l’origine de cette difficulté réside le fait que la Justice et les Médias définissent un même objet (l’égalité d’accès des citoyens à l’espace public) dans des termes diamétralement opposés et contradic- toires : pour le Droit, le véritable espace public, c’est le prétoire ; pour les médias, c’est la libre information. Le résultat de cette incompréhension débouche sur une confrontation désastreuse où chacun pense pouvoir utiliser l’autre au profit de ce qu’il estime être le fonctionnement vertueux de l’espace public. A cela s’ajoute le fait que les médias se voient critiqués parce qu’ils contribuent à déstabiliser l’institution judiciaire en insistant sur ses dysfonctionnements. Au regard des professionnels de la Justice, l’avenir du couple Médias-Justice semble aujourd’hui très compromis. Les torts sont attribués aux seuls membres de la Presse et la seule perspective salvatrice suggérée est la création d’un code de déontologie des journalistes.
La question de la relation de l’institution judiciaire avec la sphère politique comporte deux volets relativement indépendants : les rapports avec les hommes politiques d’un côté, les rapports avec le pouvoir exécutif – et donc avec la Chancellerie – de l’autre.
Un des motifs de mésentente entre les acteurs du judiciaire et les hommes politiques correspond à un conflit de légitimité, certains élus semblant considérer que l’autorité qu’ils tiennent du suffrage universel l’emporterait sur celle des juges.
Le rapport avec le pouvoir exécutif s’inscrit presque totalement dans le lien de subordination du Parquet à l’égard du Garde des Sceaux. La plupart des professionnels rencontrés se sont déclarés hostiles à l’abolition de ce lien qui assure, à leurs yeux, une nécessaire cohérence de la politique pénale appliquée sur l’ensemble du territoire et participe de la légalité des poursuites à laquelle il confère l’autorité de la décision prise au nom de la collectivité. Ce qui justifie le lien entre le Parquet et la Chancellerie, est-il affirmé, c’est qu’il établit une relation fonctionnelle entre la Justice et l’État et non entre la Justice et le Gouvernement. C’est la raison pour laquelle les professionnels de la Justice souhaitent des garanties pour que cette dépendance ne puisse pas servir au jeu politique lui-même. Trois suggestions sont proposées : la transparence et la publicité des instructions, la suppression des instructions particulières et la création d’une instance supérieure au Parquet, composée de personnalités indépendantes. En ce qui concerne la gestion de la carrière des magistrats du Parquet, la plupart des professionnels souhaitent qu’elle s’aligne sur celle des magistrats du siège.
Du côté des avocats se manifeste le regret d’une formation très théorique qui se révèle un peu décalée par rapport aux nécessités du quotidien dans les cabinets.
L’idée d’une formation commune est plutôt bien accueillie par les professions de Justice dans la mesure où elle constitue justement une réponse possible au risque de cloisonnement entre des métiers complémentaires. Ce qui est souhaité n’est pas l’unification des formations, chacune des fonctions judiciaires possédant sa spécificité, mais la mise en place de « troncs communs » pour les formations initiales et l’organisation de stages croisés entre les diverses professions de Justice. Ces stratégies de rapprochement sont parfois contestées au nom du respect des différences existant entre ces métiers.
Eu égard à la rapidité des évolutions profes- sionnelles et sociétales, qui se traduisent par le développement de nouvelles techniques et par des mutations de la réalité sociale, la formation continue apparaît comme une réponse adaptée tant à la demande d’ouverture des professions de Justice sur la société qu’à l’exigence de sensibilisation aux nouvelles technologies que ces professions expriment. Seul obstacle évoqué à la formation permanente, le manque de temps auquel certains moyens modernes d’information (la vidéo en particulier) pourraient remédier..
En ce qui concerne l’exercice des métiers du droit dans un espace qui serait européen et non plus seulement national, la première réaction des personnes consultées est de considérer que toutes les professions ne sont pas également concernées par ce mouvement, celle d’avocat se trouvant en première ligne. L’ouverture des frontières ne devrait cependant pas se traduire par un mouvement de migration généralisé, les échanges passant proba- blement d’abord par le développement de réseaux européens de professionnels. C’est d’ailleurs sur ce terrain des institutions que portent les principales suggestions avancées pour améliorer l’efficacité du futur droit communautaire : mise en commun des moyens et contacts directs entre professionnels, harmonisation des procédures dans les textes qui les établissent et dans les règles de leur interprétation Cest finalement l’image d’une législation commune réduite à un nombre très limité de domaines (les libertés publiques principalement) qui se dégage des projections.